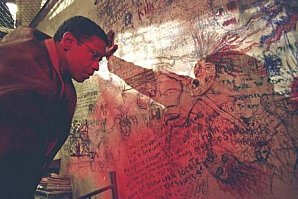- Accueil
- Dans les salles
- Cinéastes
- Pas morts
- Vivants
- Abdellatif Kechiche
- Arnaud Desplechin
- Brian de Palma
- Christophe Honoré
- Christopher Nolan
- Clint Eastwood
- Coen brothers
- Darren Aronofsky
- David Fincher
- David Lynch
- Francis Ford Coppola
- Gaspar Noé
- James Gray
- Johnnie To
- Manoel de Oliveira
- Martin Scorsese
- Michael Mann
- Olivier Assayas
- Paul Thomas Anderson
- Paul Verhoeven
- Quentin Tarantino
- Ridley Scott
- Robert Zemeckis
- Roman Polanski
- Steven Spielberg
- Tim Burton
- USA
- France
- Et ailleurs...
- Genre !
- A la maison
- Mais aussi
- RSS >>
- Rachel se marie, de Jonathan Demme (USA, 2008) ; et Un crime dans la tête (2004), du même homme
Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Où ?
A l’UGC Orient-Express pour Rachel se marie, et à la maison en DVD zone 1 pour Un crime dans la tête
Quand ?
Il y a deux semaines
Avec qui ?
Ma femme, et seul
Et alors ?
Ingmar Bergman meets Cloverfield. C’est par cet improbable mélange des genres
que l’on peut définir au mieux Rachel se marie. Le cinéaste Jonathan Demme est un véritable touche-à-tout ; pour preuve, l’enchaînement Le silence des agneaux
– Philadelphia qui lui a apporté toute la reconnaissance possible au début des années 1990. Depuis, Demme alterne fictions qui sonnent comme autant de défis (que des adaptations
de romans et des remakes) et documentaires personnels et engagés, sur la musique ou la politique. Rachel se marie est le premier long-métrage de fiction du cinéaste – en tous les
cas depuis ses œuvres de jeunesse, à la fin des années 1970 – à reproduire cette promiscuité avec les personnages, à se libérer des règles du jeu hollywoodien.

La proximité avec Cloverfield tient à ce choix d’un filmage au cœur de l’action, à l’aide d’une petite caméra numérique qui attribue au spectateur un point de vue de participant à
la perception parcellaire, plutôt que d’observateur externe et omniscient. Demme se montre très à l’aise avec les codes de cette nouvelle manière de mettre en scène – montage volontairement
heurté, scènes incomplètes dont l’on n’attrape que des fragments, mouvements de caméra qui découvrent les décors sur le moment, y cherchent l’action et en subissent le déclenchement. Il
s’autorise même, l’espace d’un instant, une manœuvre comparable à celles qui scandent Cloverfield en brisant le mur entre les personnages et les spectateurs : à une séquence
du film, il fait succéder un contrechamp nous montrant la personne qui filmait la dite séquence avec son caméscope numérique. L’homme, qui est de fait propulsé au rang de filmeur de Rachel
se marie, appartient dans le même temps au récit puisqu’on le voit immédiatement se faire apostropher en riant par un autre invité – « Put down that camera, for one
second ! ». Et puis quoi encore ? On a un film à voir nous !

Les inconnus de Cloverfield enregistraient la dévastation de Manhattan par un monstre géant ; ceux de Rachel se marie se contentent des derniers préparatifs
du mariage du titre, et de la cérémonie. Soit trois jours dont le déroulement réglé comme du papier à musique va être largement mis à mal par l’irruption d’une invitée surprise : Kym, la
sœur de la fameuse Rachel. Kym a un bon de sortie de son institut de cure contre l’alcoolisme, juste pour la durée du mariage ; et elle amène avec elle les lourds secrets et drames familiaux
que ses proches ont pris soin d’enterrer dans un recoin de leurs mémoires tandis que Kym en payait physiquement et moralement le prix pour eux tous. La filiation thématique avec Bergman est
évidente, en particulier des œuvres telles que Sonate d’automne. La qualité première du film de Demme est cependant d’être resté foncièrement ancré dans la société américaine, et
d’avoir simplement transplanté les visées cathartiques du cinéaste suédois sur des situations et des problématiques typiques des Etats-Unis. En traitant, de manière directe ou bien abstraite,
d’un mariage à grand spectacle (« à l’américaine » ; le réalisateur porte d’ailleurs un regard assez moqueur sur ce genre de manifestation fourre-tout et superficielle), d’une
société faite de brassage ethnique (le futur époux de Rachel, Sidney, est noir, et avec lui la moitié des invités), de familles divorcées et recomposées, de séminaires d’alcooliques anonymes,
etc., Demme fait avant tout preuve d’honnêteté et de courage, en gardant les deux pieds ancrés dans la réalité de son pays. Le parti-pris d’une mise en scène légère et ouverte aux imprévus est le
complément parfait d’un tel positionnement sur le fond ; il évite en effet à Rachel se marie d’avancer 1h50 durant avec un gros néon clignotant « Film à message
sociologique » sur le front.

Les réveils de blessures passées et les disputes violentes sont ainsi assujettis au rythme strict du programme, formel ou informel, du week-end. Ce qui nous réserve plusieurs fins de scènes
étonnantes, faites d’une brusque rupture de ton : la découverte inattendue faite par le père, à la fin d’un joyeux concours de remplissage de lave-vaisselle, d’une assiette qui appartenait à
son fils décédé alors qu’il n’était qu’un enfant ; l’annonce surprise par Rachel qu’elle est enceinte, pour mettre fin sur cette pirouette à une engueulade avec Kym, où tous les coups sont
permis et toutes les vérités refont surface. De même, le film s’autorise à ouvrir de longues parenthèses qui cadrent avec les réjouissances principales. Le dîner de répétition, la soirée dansante
qui suit la (vraie) cérémonie sont autant de très belles séquences, majeures dans le récit, au cours desquelles la relation conflictuelle entre les deux sœurs est mise sous silence. La double
passion de Demme pour la musique (il a tourné plusieurs documentaires autour de ce thème) et pour les individualités qui peuplent ses films – absolument tous les seconds rôles sont parfaits -
permet à cet hétéroclite melting-pot de fonctionner sans écueil. On se passionne autant pour la surface des événements du mariage que pour la progression souterraine de l’intrigue familiale.
Laquelle, magnifiée par les interprétations à fleur de peau des très dissemblables Anne Hattaway et Rosemarie DeWitt (un excellent choix de casting, qui confère à chaque sœur son identité
propre), s’achève sur une trêve ténue. La réussite n’est que douce-amère, tant le respect de cet armistice ne semble tenir qu’à la conscience des deux jeunes femmes qu’elles risquent bien de ne
plus se revoir, au moins pour une longue période.

Un revisionnage du précédent long-métrage de Jonathan Demme, le thriller politico-paranoïaque Un crime dans la tête, met à jour un nombre surprenant de passerelles entre les deux
films. Tous deux parlent d’un même monde, notre monde occidental actuel, mais en en décrivant des facettes antinomiques – grossièrement, la paix préservée à l’intérieur (Rachel se
marie) et la guerre déplacée à l’extérieur (Un crime dans la tête). Chaque film est le contrechamp aveugle de l’autre. On pourrait même s’amuser à imaginer qu’ils sont
reliés à notre insu, en deux points de détail : l’acteur qui joue le père dans Rachel se marie, Bill Irwin, fait une courte apparition au début d’Un crime dans la
tête – peut-être dans le même rôle ? ; dans le sens inverse, le soldat revenu en permission du front irakien pour fêter le mariage de Rachel et Sidney crée un lien avec
l’arrière-plan d’Un crime dans la tête, qui se nourrit du mystérieux syndrome de la Guerre du Golfe.

Les deux films partagent par ailleurs une même trajectoire scénaristique, en provoquant la plongée dans la préparation et la réalisation d’une circonstance primordiale pour les personnages qui y
participent – le mariage, une élection présidentielle. Le spectateur s’y trouve proprement dépassé par les événements, car il n’était pas présent initialement ; et en cela, nous sommes dans
la même situation que le héros du récit, qu’il s’agisse de Kym sortant de sa cure ou du Major Marco (Denzel Washington), simple soldat démobilisé qui croit mordicus en l’existence d’un complot
impliquant le futur vice-président, aux côtés duquel il a combattu au Koweït. Formellement, les rapprochements sont également nombreux, le plus évident étant le choix d’une caméra à l’épaule
quasi permanente, située au niveau des personnages et de l’action en train de se faire, au milieu des écrans et des flashs infos permanents.

Dans Un crime dans la tête, l’exception majeure à ce principe intervient lors des visions et cauchemars des protagonistes ; lorsque le sol de la réalité se dérobe alors sous
leurs pieds. Le prologue du film est de ce point de vue une pure merveille. À une mise en place repoussant le plus possible tout positionnement clair dans l’espace (un long plan fixe au sein d’un
groupe de soldats dans un lieu clos non déterminé ; puis la révélation qu’il s’agit d’un Hummer au milieu du désert ; puis une discussion entre deux autres personnages ; et enfin, un plan large
indiquant que ces deux hommes ne sont pas à l’avant du Hummer, mais dans une jeep située à côté) succède une scène d’action en vision de nuit aussi irréelle que celle de Rollerball. Un flash forward violent, accompagné d’une
voix-off soudaine sortie de nulle part, nous propulse violemment dix ans après les faits, dans le gymnase d’une école américaine, aux côtés du Major Marco. Là, le récit visuel que l’on vient de
nous faire se voit immédiatement mis en cause par la rencontre de Marco avec un de ses anciens hommes. Leur discussion prend la forme d’un champ / contrechamp foudroyant, presque plus
cauchemardesque que ce qui a précédé ; les deux hommes y parlent chacun leur tour face caméra, dans un geste de rupture avec la grammaire élémentaire du cinéma tellement volontaire et appuyé
qu’il provoque un malaise vertigineux.

Le tranchant d’Un crime dans la tête continue à nous agresser tout au long du récit ; en particulier lorsqu’il s’agit de nous révéler les arcanes de la conspiration. Des
révélations qui sont aussi brutes et aveuglantes que les couleurs primaires utilisées très crûment dans la photographie et les décors. La violence de la méthode nous prend de court, nous pousse
presque dans les bras de l’incrédulité. Il faudra un reset extrêmement osé du film à sa moitié pour remettre les choses dans le bon sens, et ainsi s’opposer à la dureté de la sentence
« We were all brainwashed » qui fait office d’état des lieux valable autant pour les personnages que pour les spectateurs.