- Accueil
- Dans les salles
- Cinéastes
- Pas morts
- Vivants
- Abdellatif Kechiche
- Arnaud Desplechin
- Brian de Palma
- Christophe Honoré
- Christopher Nolan
- Clint Eastwood
- Coen brothers
- Darren Aronofsky
- David Fincher
- David Lynch
- Francis Ford Coppola
- Gaspar Noé
- James Gray
- Johnnie To
- Manoel de Oliveira
- Martin Scorsese
- Michael Mann
- Olivier Assayas
- Paul Thomas Anderson
- Paul Verhoeven
- Quentin Tarantino
- Ridley Scott
- Robert Zemeckis
- Roman Polanski
- Steven Spielberg
- Tim Burton
- USA
- France
- Et ailleurs...
- Genre !
- A la maison
- Mais aussi
- RSS >>
- Arrête-moi si tu peux, de Steven Spielberg (USA, 2002)
Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!
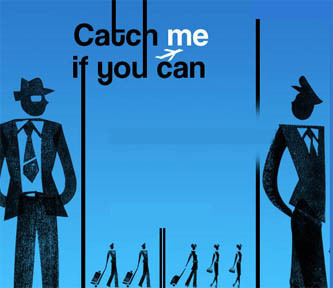
Où ?
A la maison, en DVD
Quand ?
Samedi soir
Avec qui ?
MaFemme
Et alors ?
Avant Mad men, il y a eu
Arrête-moi si tu peux. La très bonne, puis moins bonne série de Matthew Weiner n’a pas inventé la dualité consistant à
reprendre en façade les éléments de représentation idyllique des années 1950-1960, tout en exposant crûment la détresse et les épreuves intimes d’individus ayant vécu cette époque rayonnante.
Steven Spielberg et son héros complexe et bien réel Frank Abagnale sont passés par là. L’histoire vraie de ce dernier a tout pour perpétuer le mythe des swinging sixties : entre ses
16 et ses 19 ans, Frank s’est fait passer pour un pilote de ligne puis pour un médecin, et a mené une combine de chèques falsifiés particulièrement fructueuse, avec presque quatre millions de
dollars amassés au total. Entre ce parcours de gentleman-voleur (aucun acte de violence physique, une fraude uniquement dirigée contre les banques et la Pan Am), l’incarnation de Frank par
Leonardo Di Caprio et l’éclat de la reconstitution, Arrête-moi si tu peux porte la promesse d’un glamour sans limite et sans parasitage. Le générique d’ouverture, aérien
et élégant, est une véritable rampe de lancement pour ces attentes – vite prises à revers. De prisons insalubres en appartements modestes, et de bureaux anonymes en riches maisons mais que l’on
ne voit que de l’extérieur, le monde que Arrête-moi si tu peux arpente est essentiellement sombre, triste d’une tristesse qui habite aussi les personnages. Ceux-ci
passent leurs veillées de Noël en solitaires et, dans l’intervalle entre deux, consacrent leur temps à tenter de calmer le courroux de leurs créanciers ; qu’ils soient financiers (pour le
père de Frank) ou sentimentaux – un autre père, celui de la fiancée de Frank qui l’a reniée à la suite d’un avortement.

En lui adjoignant des spectateurs (son père, sa fiancée) au sein même du film, et donc en superposant aux nôtres leur regard et leurs aspirations, Spielberg retire à la folle aventure de Frank
son potentiel caractère hédoniste. Loin d’être insouciante, elle devient la fugue par procuration de tous les oubliés et écrasés que cette époque, comme toutes les autres, a fabriqués. Elle est
leur lueur d’espoir à laquelle rêver pour ne plus penser à leur propre vie, claquemurée de toutes parts. Si l’histoire de Frank Abagnale est par bien des aspects une belle histoire, ce n’est pas
pour autant toutes les histoires. En réalité, c’est une histoire très proche de celles en apparence plus dures qui l’encadrent dans la filmographie de Spielberg, A.I. et
Minority
report (et dire que le cinéaste a mis en boîte ces trois merveilles en 18 mois !). Comme le robot David dans le premier et l’inspecteur déchu John dans le second,
Frank court sans but défini au devant de lui, mû par la seule volonté d’échapper au gouffre qui s’est ouvert un jour sous ses pieds et a englouti les fondations de son existence. Il est brillant
– il le faut pour déployer un tel étalage d’intelligence et d’habileté – mais détruit intérieurement par l’annonce du divorce de ses parents. Toujours comme c’est le cas dans
A.I. et Minority report, Spielberg parvient par on ne sait quel miracle cinématographique à faire coexister dans sa mise en scène la splendeur
plastique extérieure du monde (futuriste dans ces deux cas, nostalgique dans Arrête-moi si tu peux ; et à chaque fois source d’émerveillement) et l’ambivalence
tourmentée et intériorisée du héros. Ces deux guides du récit, l’un positif et l’autre négatif, sont traités avec la même franchise, faisant de chacun des trois films une œuvre duale, ambiguë, et
donc forcément captivante. Le happy-end de Arrête-moi si tu peux se défait un peu trop facilement de cette précarité, en se focalisant sur Frank et en négligeant
les autres – tous ceux qui, comme son père et peut-être son ex-fiancée, n’avaient pas la chance d’être dotés des ressources suffisantes pour renverser les montagnes bloquant leur chemin. Vouloir
nous les faire oublier, et de ce fait choisir in extremis le camp du divertissement positif, est la seule petite fausse note du film.

